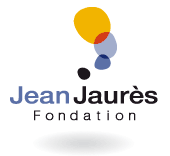« En 1981, la gauche ne pouvait pas revenir au pouvoir sans appliquer un programme ambitieux »
Le 18/06/2022
Pierre-Alain Muet
Economiste, ancien député
La gauche qui arrive à l’Elysée en 1981 voulait « changer la vie ». Son programme était bien loin de se résumer à une relance conjoncturelle, comme on le présente encore aujourd’hui. Son objectif était réellement de transformer la société, en accordant plus de place aux loisirs par la réduction du temps de travail et la retraite à 60 ans. La croissance devait autofinancer les avancées sociales. L’Etat devait jouer un rôle économique important grâce aux nationalisations, à la création d’emplois publics et au développement d’un capitalisme d’Etat qui devait servir à bâtir les fondements de la compétitivité de l’économie française.
Mais, voulant tout faire trop vite, le gouvernement a dû changer de cap. Lorsque Lionel Jospin, Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry accèdent au pouvoir en 1997, ils gardent en mémoire ce qui s’est passé au début du premier septennat de François Mitterrand, dont ils ont étudié de très près la politique économique. Leur but ? Mettre en place leur programme mais sans « pause, ni recul, ni reniement », dira Lionel Jospin lors de son discours de politique générale.
Pierre-Alain Muet était économiste à l’OFCE au moment de l’élection de François Mitterrand, il en a été l’un des observateurs clés (voir son livre sur le sujet paru en 1985). Puis, en tant que conseiller économique du Premier ministre Lionel Jospin, il a été au cœur du pouvoir socialiste. Avant de devenir député PS et de rejoindre les frondeurs contre le changement de politique économique de François Hollande. Dans cet entretien, il revient sur la dimension économique de la gauche au pouvoir.
Quelle a été l’ampleur de la relance réalisée par la gauche au pouvoir après son arrivée au pouvoir en 1981 ?
Pierre-Alain Muet : Son montant (1,7 point de PIB en 1981-1982) était un peu inférieur aux relances mises en œuvre par Jacques Chirac (2,3 % en 1975-1976) ou par Helmut Schmitt en Allemagne (2,2 % en 1979-1980) et du même ordre de grandeur que ces deux dernières lorsqu’on y ajoute les mesures de relance préélectorales du gouvernement de Raymond Barre (0,5 point en 1981). Car, il faut se rappeler que, juste avant les élections de 1981, le gouvernement a eu recours à une relance méconnue mais réelle pour tenter de remporter le scrutin. J’ai eu l’occasion d’en parler avec Raymond Barre, il n’a pas du tout aimé l’expression de « relance préélectorale », même si c’en était une !
Quelles étaient les spécificités de cette relance ?
P-A. M. : A la différence des relances Chirac ou Schmitt qui étaient conjoncturelles et dont l’impact s’éteignait rapidement (aides fiscales temporaires, reports d’impôts, accélération temporaire des investissements publics pour la relance Chirac), ce que l’on a appelé la relance de 1981-1982 était en fait un ensemble de mesures structurelles destinées à réduire les inégalités et à renforcer le secteur productif (hausses du Smic, des retraites et des allocations familiales, créations d’emplois publics, investissement dans le secteur public et nationalisé, etc.).
Etait-ce une remise en cause des débuts du libéralisme économique lancé par le Président Giscard d’Estaing ?
P-A. M. : Vous savez, à l’époque, tout le monde se prétendait keynésien ! Mais il y avait de fait le souhait de réaffirmer le rôle de l’Etat dans l’économie. Après Pompidou et Giscard d’Estaing, la gauche voulait renouer avec la figure d’un gaullisme étatique orientant l’économie. En oubliant que le rigoriste Antoine Pinay avait longtemps été le ministre des Finances de De Gaulle.
Son objectif n’était donc pas principalement conjoncturel...
P-A. M. : Il l’était d’autant moins que les prévisions publiées en 1981 escomptaient toutes une reprise de l’économie mondiale en 1982. Et c’est d’ailleurs sur cette base que le gouvernement Mauroy espérait pouvoir financer sans problème son programme de réformes structurelles. La croissance était censée financer toutes les mesures sociales.
Mais la reprise mondiale attendue s’est muée en récession en Europe sous l’effet des politiques d’austérité. La France a donc bien mené dans les faits une politique parfaitement contracyclique qui lui a permis d’avoir une croissance de 1,8 % quand le reste de l’Europe était en stagnation ou en récession. Mais la contrepartie a été une forte dégradation du commerce extérieur imputable au décalage conjoncturel avec nos partenaires.
Quand on veut mettre en œuvre une politique de soutien actif à l’activité, on ne peut le faire que lorsque les autres le font ?
P-A. M. : Dans le cadre européen, on peut toujours le faire, mais c’est surtout efficace pour les politiques de l’offre. Les politiques de demande sont coopératives par nature, quand un pays relance, les autres en profitent. Il vaut donc mieux les conduire simultanément avec les autres partenaires.
Une politique de l’offre, notamment par une réduction du coût du travail, fait exactement le contraire : plus on la mène seul, plus on en bénéficie au détriment de ses partenaires. C’est exactement ce qu’a fait l’Allemagne au début des années 2000.
Je me souviens des conversations que j’avais avec Emmanuel Macron sous le mandat de François Hollande. Il me disait qu’il était d’accord avec le keynésianisme à l’échelle de l’Europe mais, qu’au niveau national, il fallait donner la priorité aux politiques de l’offre. Ce qui n’est guère cohérent, car il n’y a pas de politique économique européenne en dehors de la somme de celles que mènent les pays de l’Union.
Ce sont les idées qu’il a fait passer au Président : l’Europe a un déficit de demande mais nous, en France, nous avons un problème d’offre, il faut donc mener une politique de l’offre.
En réalité, nous avions comme tous les pays européens un problème de demande résultant des politiques d’austérité autrement plus important que notre déficit structurel de compétitivité dans le secteur industriel.
Parmi les mesures structurelles, la gauche passe la durée du travail à 39 heures et instaure la cinquième semaine de congés payés. Quels en ont été les effets ?
P-A. M. : L’enquête réalisée par l’Insee auprès des entreprises et les travaux de la Direction de la Prévision ont montré que, contrairement aux discours tenus depuis toujours par les conservateurs, il n’y a eu aucune baisse de la production à la suite de la réduction du temps de travail.
En revanche, les gains de productivité en ont limité l’impact sur l’emploi, avec 60 000 emplois créés environ au lieu des 100 000 que l’on pouvait en attendre.
Les 110 propositions de François Mitterrand prévoyaient de passer aux 35 heures. Une occasion perdue ?
P-A. M. : Non, parce que l’on manquait à l’époque d’expériences de passage aux 35 heures dans les entreprises avec un soutien public. Contrairement à la majorité des économistes de mon département à l’OFCE, je n’étais guère convaincu par les simulations des modèles macroéconomiques qui décrivaient d’importantes créations d’emplois avec le passage aux 35 heures.
C’est l’étude des effets de la loi Robien de juin 1996 qui m’a fait changer d’avis : la combinaison d’un dispositif de baisse des cotisations, inspiré de la loi Robien, et d’un abaissement de la durée légale à 35 heures pouvait créer des emplois de façon importante, même avec le maintien du salaire mensuel. C’est en fait ce que nous avons mis en œuvre en 1997 avec Lionel Jospin avec, cette fois, un impact important sur l’emploi de l’ordre de 350 000.
Il y a eu également la création de beaucoup d’emplois publics.
P-A. M. : La proposition n °18 du candidat Mitterrand stipulait que 150 000 emplois seraient créés dans les services publics et sociaux et 60 000 emplois d’utilité collective mis à la disposition des associations et des collectivités locales. La première mesure a été totalement mise en œuvre (143 000 emplois publics ont été créés), la seconde l’a été seulement pour moitié.
La création directe d’emplois dans le secteur non marchand, quelle qu’en soit la forme, est de loin la mesure la plus efficace pour relancer une économie, car en augmentant le revenu du salarié qui trouve ou retrouve un emploi, elle augmente le revenu national et a un impact très rapide sur l’activité.
Le problème est que la création d’emploi dans la fonction publique a un coût budgétaire permanent qui ne peut pas être inversé sans remise en cause de la politique qui l’a lancée. La leçon a été retenue avec succès par la suite en utilisant des emplois aidés, dont le montant pouvait aisément être adapté à la conjoncture, à l’instar des emplois jeunes en 1997 ou des emplois aidés sous Jean-Louis Borloo en 2006.
Cela veut-il dire qu’il faut une sorte de garantie d’emplois publics temporaires quand la conjoncture se dégrade ?
P-A. M. : Bien sûr. Je suis partisan de ce que l’on a appelé « les emplois jeunes ». Offrir des emplois qui peuvent mener à la professionnalisation en période de basse conjoncture est une bonne mesure. C’est ce qui a permis de relancer l’économie à la fin des années 1990 avant que la réduction du temps de travail fasse sentir ses effets.
Et le passage à la retraite à 60 ans (pour 37,5 années de cotisations) ?
P-A. M. : A cette époque l’abaissement de l’âge de départ à la retraite était totalement pertinent, car la plupart des salariés avaient commencé à travailler très tôt et avaient bien plus de 40 années de cotisations quand ils atteignaient l’âge de 60 ans.
Car ce qui est juste en matière de retraite, ce n’est pas l’âge de départ mais la durée de cotisation. Pourquoi un ouvrier ayant commencé à travailler à 15 ans devrait-il partir au même âge qu’un cadre ayant débuté à 25 ?
Il est dommage que l’on n’ait pas profité de cet abaissement de l’âge à partir duquel on peut faire valoir ses droits à la retraite pour programmer l’augmentation de durée de cotisation en fonction de l’espérance de vie. Par exemple, on aurait pu dire, on peut partir à la retraite après 37 annuités augmentées d’un tiers de l’accroissement de l’espérance de vie.
Il faut juste fixer un âge à partir duquel quelqu’un qui a eu une carrière incomplète, ou, pire, qui n’aurait jamais travaillé de sa vie, a le droit à une retraite. Mais il faut que ce soit la durée de cotisation qui soit le facteur déterminant, car c’est juste socialement.
La réforme n’aurait touché personne avant une décennie et le problème des retraites aurait été presque définitivement réglé sur le plan financier sans qu’il soit nécessaire de faire régulièrement des « réformes » douloureuses.
La gauche voulait alors développer une industrie nationale grâce aux nationalisations, au crédit public et l’investissement dans la R&D. Ce capitalisme d’Etat a-t-il fonctionné ?
P-A. M. : En partie oui, mais il était en complet décalage avec la politique de nos partenaires européens. Et ce programme de nationalisations, issu du programme commun signé par les partis de gauche en 1972, n’avait pas été réactualisé alors que le contexte économique avait profondément changé après les chocs pétroliers.
Comme le soulignait Michel Rocard, il n’était pas nécessaire de nationaliser à 100 % les entreprises concernées, et il manquait surtout une réflexion approfondie sur les concepts de service public et de secteur public, qui étaient trop souvent confondus dans les réflexions de la gauche.
Les missions de service public peuvent être rendues par des acteurs privés. Les collectivités locales fonctionnent en permanence selon ce principe, les transports et autres restent des services publics, mais dans le cadre de délégation au secteur privé. La gauche de 1981 identifiait le service public au secteur public.
Or, la gauche ce n’est pas à mon sens le public contre le privé. C’est définir des missions de service public et savoir comment on les met en œuvre le plus efficacement possible. Il y avait des entreprises industrielles nationalisées qui ne rendaient pas de services publics !
Cette réflexion a été l’une des préoccupations majeures de la gauche quand elle est revenue au pouvoir en 1997. C’est pour cela que Lionel Jospin a demandé, dès sa création, que l’un des premiers rapports du Conseil d’analyse économique porte sur la question « service public, secteur public ».
Au final, quels ont été les effets de ces politiques sur la croissance et l’emploi ?
P-A. M. : La France a traversé la récession de 1981-1982 sans connaître de ralentissement marqué de sa croissance contrairement à la plupart des pays européens, l’emploi a augmenté de 320 000 personnes en deux ans et le chômage est resté stable, alors qu’il augmentait fortement ailleurs. Mais ces évolutions se sont inversées à partir de 1983 avec le tournant de la rigueur.
En effet, à partir de la fin 1982, face à la montée des déficits extérieurs et publics, le gouvernement engage une politique de rigueur : contrôle des prix et des salaires, désindexation des salaires sur les prix et la productivité, stagnation de la dépense publique et baisse des impôts. Etait-ce la bonne politique ?
P-A. M. : Oui et à l’époque j’ai clairement plaidé pour soutenir la politique courageuse de Pierre Mauroy et Jacques Delors, car il fallait réduire l’inflation et les déficits.
La politique de désindexation mise en œuvre par Jacques Delors a été particulièrement pertinente.
La politique d’indexation revient à constater la hausse des prix passée, puis à ajuster les salaires pour rattraper la perte de pouvoir d’achat.
La politique de désindexation progressive a consisté à indexer l’évolution des revenus futurs sur un objectif d’inflation de l’année suivante fixé par le gouvernement (inférieur à l’inflation observée) pour briser la hausse cumulative des prix et des salaires qui perpétuait l’inflation.
Cela a permis de réduire l’inflation sans recourir aux politiques d’austérité massive qu’avaient menées la plupart de nos partenaires européens. Lorsque l’on étudie statistiquement les effets de la désindexation, on s’aperçoit qu’elle explique pour moitié la maîtrise de l’inflation en France durant cette période, un impact important.
Pourquoi ne pas avoir pris une autre voie : une dévaluation du franc et un peu de protectionnisme ?
P-A. M. : Le débat a existé à gauche et au sein même du gouvernement, mais au plus mauvais moment : lors de la troisième dévaluation du franc en mars 1983, alors que l’endettement avait augmenté et que les réserves de change étaient au plus bas.
Par ailleurs, la lenteur du rétablissement des échanges extérieurs à la suite des trois réajustements de parité montrait que le poids pris par la facture énergétique après les chocs pétroliers augmentait fortement l’effet pervers du renchérissement des importations, la fameuse courbe en « J » était longue : après une dévaluation, le solde extérieur commence par plonger du fait du renchérissement immédiat du prix des importations avant de se redresser grâce à la plus grande compétitivité des exportations, mais là, le creux durait longtemps !
D’autre part, le flottement des monnaies autres que celles du système monétaire européen (SME) ne se prêtait guère à des dévaluations compétitives.
D’ailleurs, l’étude des dévaluations réussies de 1958 et 1969 montrait que, même dans le contexte favorable de Bretton Woods, les dévaluations ne se substituaient jamais à la rigueur et que celle-ci était une condition nécessaire à leur réussite.
Mais, en refusant de sortir du SME, ce fut surtout le choix politique de la construction européenne que fit Mitterrand. Et à long terme, ce fut un choix décisif pour notre pays et pour l’Europe.
Quelles ont été les erreurs de la gauche lors de l’arrivée au pouvoir ?
P-A. M. : Si un économiste oublie le contexte politique et analyse aujourd’hui ce qui s’est passé, il en conclura qu’il fallait faire une petite relance ponctuelle en 1981-1982 et programmer les réformes structurelles sur l’ensemble du mandat.
Mais la politique est plus compliquée que ce que suggère la simple analyse économique. On sait bien que les réformes qui ne sont pas faites dans les premières années du pouvoir ne le sont jamais.
Et la gauche ne pouvait pas revenir au pouvoir après plus de deux décennies d’opposition sans mettre en œuvre un programme ambitieux. Pour faire quoi ? Lutter contre l’inflation et les déficits extérieurs ? C’est ce que faisait Raymond Barre ! Ce n’était pas possible. Il fallait commencer par des mesures plus ambitieuses et c’est ce qu’a fait la gauche.
Je pense qu’on ne pouvait pas faire autrement. Mais le traumatisme de 1983 a servi de leçon. Quand la gauche est revenue au pouvoir en 1997, c’était avec un programme calibré pour « qu’il s’inscrive dans la durée ... et qu’il n’y ait ni pause, ni recul, ni reniement », comme l’a dit Lionel Jospin lors de son discours de politique générale à l’Assemblée le 19 juin 1997.
A cette époque, nous voulions éviter les erreurs de 1981 et être sûrs de ne pas être obligés de nous renier en cours de route.
Et aujourd’hui, une fois les leçons tirées de la gauche de 1981 et celle de Lionel Jospin quels devraient être les grands axes d’une politique de gauche ?
P-A. M. : J’apprécie le fait que la gauche ait réalisé son unité, c’était nécessaire. Je ne sais pas ce que donnerait le programme qu’elle propose. Ce n’est pas du mitterrandisme. François Mitterrand, comme Lionel Jospin plus tard, représentait le centre de gravité de la gauche de son époque ; là c’est plutôt la gauche de la gauche. Je reste fondamentalement un social-démocrate.
Quand sous François Hollande la gauche glisse à droite, je me retrouve avec les frondeurs à gauche de la « gauche ». Quand elle va à la gauche de la gauche, je me retrouve dans le centre gauche ! La gauche, c’est aussi le débat.