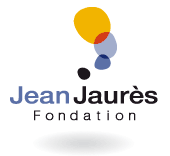Dans la principauté éclairée de Wiseland, le Prince qui avait lu les philosophes, voulait créer une protection sociale universelle consistant en un revenu de 600 écus versé à tout le monde. Il voulait le financer, soit par une extension de l’impôt sur le revenu déjà existant, soit par un nouvel impôt qui financerait exclusivement ce revenu universel. Son ministre des finances lui ayant objecté le coût excessif de cette proposition il fit appel à Zadig, qui conseilla en d’autres temps le roi de Babylone, pour lui demander de l’aide.
Le Prince : Mon cher Zadig, vous qui avez réglé la dispute entre les adeptes du temple, peut-être pourrez-vous m’aider à résoudre le conflit entre mon Ministre des affaires sociales et mon Ministre des finances au sujet de la mise en place de mon projet de revenu universel.
La proposition de mon Ministre des affaires sociales est de verser tous les mois à tous les citoyens de la principauté un chèque de 600 écus. Ce revenu universel serait financé par un nouvel impôt recouvré par le Ministère des finances. Mais mon Ministre des finances me dit que cela augmenterait de plusieurs centaines de milliards d’écus les dépenses et les recettes du royaume et rendrait notre principauté peu respectable au regard des banquiers des royaumes d’Europe.
Zadig : Mon Prince, puisque votre revenu est universel, il n’est pas nécessaire que ce soit votre Ministère des affaires sociales qui le verse. Le Ministère des affaires sociales est parfaitement compétent pour verser des allocations sous condition de ressources comme le sont la plupart de vos allocations où il faut prendre en compte différents critères personnels (logement, revenu fiscal de référence, composition de la famille...), avant de les attribuer. Mais puisque votre revenu est universel et ne dépend d’aucun critère, il peut être immédiatement versé à tous vos concitoyens par votre Ministère des finances.
Le Prince : Mais, Zadig, vous oubliez une chose. En m’inspirant d’autres royaumes européens, j’ai décidé de simplifier notre impôt sur le revenu qui est maintenant prélevé à la source. Je vais donc reverser à tous ceux qui payent déjà l’impôt sur le revenu un chèque de 600 écus, alors que j’ai supprimé dans l’autre sens le paiement par chèque de l’impôt sur le revenu ?
Zadig : Au contraire, mon Prince, c’est une excellente nouvelle ! J’avais souvenir que vous étiez la dernière principauté d’Europe à ne pas prélever l’impôt à la source, mais j’ignorais que ce n’était plus le cas. Cela change tout : plutôt que de faire un prélèvement et un versement tous les mois au même contribuable, vous allez simplifier énormément les choses. Vous allez faire les deux en même temps sans rien changer à votre projet initial de revenu universel.
Le Prince : Comment sans rien changer ?
Zadig : Puisque c’est le Ministère des finances qui prélève l’impôt et versera le revenu universel, il versera à chacun le revenu universel diminué de l’impôt sur tous les autres revenus. Pour ceux qui n’ont pas d’autres revenus, ce sera un versement de 600 écus. Pour les autres, le Ministère des finances leur versera ou leur prélèvera la différence entre le revenu universel de 600 euros et la nouvelle imposition du revenu.
Le discours de Périgueux du candidat Hollande proposait une véritable révolution fiscale : prélèvement à la source, fusion de l’IR et de la CSG dans un grand impôt progressif, suppression des niches fiscales. Si elle avait été mise en œuvre, François Hollande serait resté dans l’histoire comme le nouveau Joseph Caillaux, tant le changement était radical. Mais ces bonnes intentions ont commencé à s’effriter au cours de la campagne, notamment quand le candidat Hollande a chaussé les habits du favori déchu - DSK -, et elles ont carrément disparu des préoccupations du président élu.
Au-delà du recul du candidat au cours de la campagne, trois facteurs, qui se sont enchaînés dès le début du mandat, expliquent cet incroyable revirement de François Hollande au pouvoir.
Le premier est le choix de privilégier la réduction des déficits plutôt que la réforme fiscale, conduisant ainsi à une accumulation de hausses d’impôts plutôt qu’à une politique cohérente de réforme qui aurait dû commencer par le prélèvement à la source.
Le second est la conjugaison de cette accumulation d’impôts et des hausses programmées par son prédécesseur qui conduisit au « ras le bol fiscal ». Loin de faire la grande réforme fiscale annoncée dans la campagne, le gouvernement tétanisé par la question fiscale passa son temps à désamorcer les bombes laissées par son prédécesseur, laissant libre cours au bricolage fiscal des services de Bercy.
Le troisième facteur fut une bombe que le gouvernement alluma imprudemment lui-même dès le début du mandat, en commandant le rapport Gallois dont la conséquence fut de rétablir et la TVA sociale et d’engager le gouvernement sur un tout autre programme.
Et c’est la question oubliée lors de la campagne électorale - la compétitivité – qui va orienter la politique fiscale vers un tout autre sujet, conduisant à ce paradoxe que les principales réformes fiscales réalisées par François Hollande auront été celles que Sarkozy proposait dans sa campagne électorale. Un tournant que résuma Arnaud Montebourg avec une formule choc : « Les Français ont voté pour la gauche et ils se retrouvent avec le programme de la droite allemande ».
Le combat de la gauche pour une réforme fiscale tire son origine du constat d’une imposition des revenus devenue profondément injuste avec la création puis la montée en charge de la CSG et la réduction quasi continue de l’impôt sur le revenu. Constituée de deux impôts profondément différents, l’IR et la CSG, notre imposition des revenus commence en effet à un taux moyen très élevé (le taux de la CSG) qui pèse fortement sur la moitié la plus modeste de nos concitoyens. Elle n’est progressive que pour l’autre moitié (qui paye l’impôt sur le revenu), confortant en outre l’idée fausse que seule une moitié des Français paieraient un impôt sur le revenu, alors que tous payent la CSG.
C’est ce constat d’une imposition injuste et le rejet par le conseil constitutionnel de la dégressivité de la CSG pour les revenus modestes sous le gouvernement Jospin qui firent émerger à gauche la proposition d’une fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG pour créer un impôt unifié, prélevé à la source, assurant une véritable progressivité de l’ensemble de notre imposition des revenus.
Porté pendant plusieurs années par le PS, cette réforme deviendra le thème majeur de la campagne présidentielle de François Hollande. Le discours qu’il prononça en ce sens à Périgueux lors de sa précampagne présidentielle serait resté un moment fondateur du quinquennat si la réforme avait été réalisée. Mais au pouvoir, c’est un tout autre programme fiscal qu’il mit en œuvre.
La question de la réforme fiscale rebondira lors de la campagne présidentielle de 2017 avec la proposition novatrice de revenu universel portée par Benoit Hamon. Mal comprise pendant la campagne présidentielle, la fusion du revenu universel dans un impôt sur le revenu rénové est pourtant à la fois la réponse pertinente à l’injustice de notre imposition des revenus et le socle d’une protection sociale adaptée au XXI siècle.
C’est cette brève histoire que je développe en 3 parties :
- 1ère partie : de l’échec de la CSG dégressive à la « révolution fiscale » du candidat Hollande,
- 2ème partie : Comment le candidat de la « révolution fiscale » devint le président du bricolage fiscal
- 3ème partie : une fiscalité et une protection sociale pour le XXIème siècle: la fusion du revenu universel et de l’impôt sur le revenu
La suite de cette note traite de la première partie : depuis l’échec de la CSG dégressive sous le gouvernement de Lionel Jospin jusqu’à la « révolution fiscale » du candidat Hollande.
Le revenu universel défendu par Benoit Hamon a été l’une des rares propositions innovantes de la dernière campagne présidentielle. Mais les campagnes présidentielles sont plus propices au prêt-à-porter idéologique qu’à la pédagogie. Pourtant, le revenu universel n’est pas une utopie couteuse, mais l’aboutissement de 30 ans de tâtonnement pour mettre en place une protection sociale adaptée au 21ème siècle.
Pour comprendre qu’il n’est ni difficile ni couteux de remplacer le RSA et la Prime d’activité par un vrai revenu universel, prenons le problème à l’envers. Supposons que notre impôt sur le revenu ait été dès l’origine prélevé à la source dès le premier euro et qu’un revenu universel d’un montant égal au RSA, versé à tous les contribuables-citoyens par l’administration fiscale ait été créé en même temps que cet impôt. A quoi ressemblerait aujourd’hui ce dispositif ?
L’administration fiscale versant tous les mois le revenu universel et prélevant tous les mois l’impôt sur le revenu ferait les deux opérations en même temps. Elle verserait donc à chaque citoyen-contribuable le solde du revenu universel et de l’impôt sur le revenu. Pour un contribuable n’ayant aucun revenu d’activité ou de remplacement, ce solde est égal au revenu universel. A partir du premier euro gagné, l’impôt sur le revenu augmente et l’allocation versée aux faibles revenus est inférieure au revenu universel puisqu’il est amputé de l’impôt sur le revenu. Enfin, lorsque l’impôt devient supérieur au revenu universel, le solde est un prélèvement.
Or c’est précisément ce que produit l’ensemble « RSA, Prime d’activité, CSG et Impôt sur le revenu », mais d’une façon incohérente. La prime d’activité consiste dès les premiers euros gagnés à verser le RSA en l’amputant de 38 % des revenus d’activités et cela jusqu’à 1,3 SMIC en 2017 (1,5 en 2019). La CSG commence (presque) au premier euro au taux moyen de 9,7 %, tandis que l’impôt sur le revenu commence à 1,2 SMIC et au taux marginal de 14 %. La CSG est individualisée alors que le RSA et l’impôt sur le revenu sont familialisés, mais d’une façon différente (le conjoint compte pour ½ part dans le RSA, une part dans l’IR). Enfin la CSG et l’impôt sur le revenu sont prélevés automatiquement alors que le RSA et la Prime d’activité doivent être demandés.
L’objet de cette note est de montrer qu’en transformant ces prestations sociales (RSA et Prime d’activité) en un revenu universel intégré dans un impôt prélevé à la source, on peut redonner une cohérence complète à notre imposition des revenus et jeter la base d’une protection sociale plus universelle et plus efficace. Et cette réforme constitue aussi une réforme fiscale qui rend l’ensemble de notre imposition du revenu (IR et CSG) plus juste, car plus progressive.
La suite de la note détaille les 3 scénarios présentés dans le dernier chapitre du livre « un impôt juste, c’est possible ». La réforme abaisse l’impôt des ménages modestes sans augmenter celui de quiconque puisqu’en créant un revenu universel intégré dans l’impôt sur le revenu, elle réduit l’impôt des contribuables modestes en commençant par un impôt négatif (un versement) puis en rejoignant l’imposition actuelle du revenu pour un seuil compris entre 1,4 SMIC (scénario 1) et 2 SMIC (scénarios 2 et 3). Les 3 critères qui différencient ces scénarios sont le montant et le champ du revenu universel (notamment son extension aux jeunes) et le point de raccord avec l’imposition actuelle.
Les simulations présentées dans la suite de cette note détaillent celles qui sont publiées de façon résumée dans l’ouvrage. Elles sont calées sur les revenus de 2017 et sur le barème de l’impôt et de la prime d’activité de l’année en question.
La vague populiste et nationaliste qui déferle sur l’Europe risque de mettre à mal la seule construction politique qui permit la paix et la prospérité de notre continent et reste indispensable pour conserver la maîtrise de notre destin.
Mais le rempart contre ces dérives n’est certainement pas la macronie, même si le Président de la république n’a de cesse de se présenter comme le défenseur du progressisme face au populisme et au nationalisme. Car Emmanuel Macron n’est pas progressiste. Sa politique n’est que le prolongement sous un autre nom des politiques de droite qui ont dominé l’Europe ces 15 dernières années, creusé les inégalités et conduit à la situation que nous connaissons.
La famille socialiste reste la principale force progressiste du Parlement européen et la seule capable de fédérer la gauche et les écologistes pour réorienter l’Europe et mettre en échec l’éclatement dont rêvent les partis europhobes.
Car le véritable enjeu de ces élections n’est pas de savoir si le Rassemblement national dépassera ou non LREM en France, mais qui de la droite ou de la gauche dominera le Parlement européen dans les 5 années qui viennent.
Attaché depuis toujours au socialisme démocratique et à la construction européenne je voterai dimanche pour la liste «Envie d’Europe», emmenée par Raphaël Glucksmann.